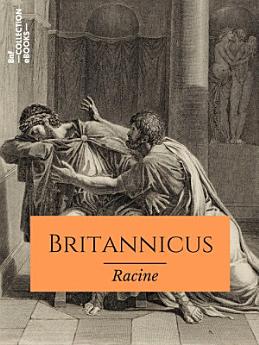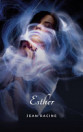Britannicus
เกี่ยวกับ eBook เล่มนี้
เกี่ยวกับผู้แต่ง
1639 - 1699. Orphelin, il est recueilli par les religieuses de Port-Royal, où il reçoit une éducation janséniste. Après avoir tenté de concilier ses aspirations littéraires avec la carrière ecclésiastique, il se consacre au théâtre. Il fait jouer la Thébaïde (1664), puis Alexandre le Grand (1665), mais c'est le succès de la tragédie Andromaque (1667) qui assure sa réputation. Il donne ensuite Britannicus (1669), Bérénice (1670), Bajazet (1672), Mithridate (1673), Iphigénie en Aulide (1674), Phèdre (1677). Nommé historiographe du roi, réconcilié avec les jansénistes, il renonce alors au théâtre. Mais, à la demande de Mme de Maintenon, il écrit encore pour les élèves de Saint-Cyr les tragédies bibliques Esther (1689) et Athalie (1691). Le théâtre de Racine peint la passion comme une force fatale, qui détruit celui qui en est possédé. Réalisant l'idéal de la tragédie classique, il présente une action simple, claire, dont les péripéties naissent de la passion même des personnages. Racine a aussi écrit une comédie, les Plaideurs (1668), spirituelle critique des moeurs judiciaires. (Académie française.)